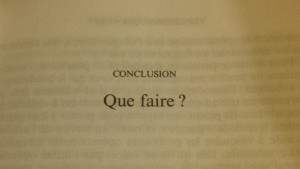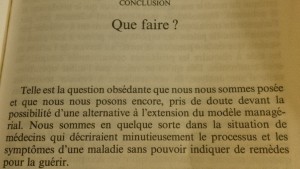Je n’aurais pas pensé ouvrir cette section sur un tel article. J’en ai des tonnes d’autres en réserve, sur les réflexes défensifs, et sur la fleur qui a failli détruire ma vie, évidemment – je pensais même ouvrir le bal avec un article de description du Narcisse.
Finalement, il vous faudra attendre un peu plus pour tout ça. Dans mon humeur actuelle, cet article-là me semble beaucoup plus important.
Aujourd’hui, j’ai quitté le travail rongée par la culpabilité, en pleurant. Culpabilité de partir plus tôt que prévu, mais incapacité à y rester une minute de plus. Les larmes étaient nerveuses, douloureuses, un mélange d’amertume, de terreur, de réviviscence… Un joyeux cocktail.
Pour ceux qui me lisent sans en savoir plus, je suis en dernière année de licence de psychologie,? spécialité ergonomie et travail.
Ça veut dire que je ne suis pas vraiment une disciple de Freud (enfin, dans la limite possible quand on est étudiant en psycho) mais surtout que je ne m’amuse pas à trifouiller dans vos têtes pour établir quel genre de névrose vous pouvez avoir. Je suis celle qui vient sur votre lieu de travail et qui observe, silencieuse, dans un coin, pour trouver des points d’amélioration dans votre travail, voir comment augmenter votre moral et votre efficience.
Je parle de « travail » plus haut, mais comme je suis en fin d’études, je suis en stage, en fait. Un micro-stage, même, qui me fait découvrir les joies des réalités en entreprise.
Bon, j’ai déjà un peu d’expérience de l’entreprise. Pas des masses, mais mine de rien, j’ai un pied dans la vie active depuis 2011, quand même. Je connais les situations de crise, les absences complètes de communication, les périodes de stress intense qui vous rongent jusqu’à la moelle et vous privent de toute forme de vie personnelle. On a beau connaître tout ça, se placer en observateur dans une entreprise, sans être un acteur à temps plein, ça ouvre les yeux sur plein de choses. Des trucs très chouettes, hein. Et aussi des réalités bien dégueulasses.
Je me place dans la catégorie des utopistes. Des idéalistes. Des rêveurs, aussi, sans doute. Moi, dans la vie, j’aime bien rendre service aux gens. J’ai une fibre sociale assez forte ; dans l’ensemble, je cerne assez bien, et assez vite, les gens. (Il y a toujours des exceptions, et non, ça ne veut pas dire que je place les gens dans des cases au premier regard, crénom.)
Ca fait de moi quelqu’un de chouette avec qui discuter, parce qu’en plus, je suis curieuse, et j’aime bien en savoir plus sur les gens qui m’entourent, et les écouter, et voir comment je peux les aider. Oui oui ! Je veux aider les gens. C’est un peu ma raison d’être depuis… depuis longtemps, en fait.
Et voilà qui m’amène au sujet précis : dans ma petite utopie personnelle, je me disais que ce serait chouette de faire un métier dans lequel j’aiderais les gens à mieux vivre. De par mon expérience personnelle, pouvoir soulager des employés et les aider à être mieux dans leur travail, c’était permettre à d’autres de ne pas vivre ce que j’ai vécu. Vous savez, ce moment où le boulot vous use jusqu’à la corde, où vous perdez goût à tout, où vous n’en faites jamais assez ?
(Ah ? J’en vois au fond qui commencent à voir le lien avec le titre. Au bout de 500 mots, en même temps, il était temps que je commence à en venir au fait. Remarquez que ce n’est pas un hasard si je tourne autour du pot : d’abord, il y a un lourd contexte à remettre ; ensuite, je suis morte de trouille parce que je sais que quand j’arriverai vraiment dans le vif du sujet, je vais me mettre à pleurer.)
Bon. Aujourd’hui, donc, je suis revenue à la réalité. Aider les gens, c’est une noble ambition ; mais à un moment il faut voir la vérité en face : globalement, la société ne veut pas qu’on aide les gens. Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne, les enfants, un peu de réalisme.
Aider les gens, ce n’est pas rentable. [1]
Je ne jetterai pas la pierre à ceux qui essaient de faire vivre leurs entreprises coûte que coûte ; même ceux qui recrutent des stagiaires avec au moins trois ans d’expérience me semblent « excusables » dans la réalité économique actuelle. La vérité c’est que pour maintenir une entreprise en vie, il faut faire beaucoup avec très peu pour tenter de gagner assez.
Alors au lieu de former un employé supplémentaire à sa sortie de l’école, de le garder, de le chérir, d’en faire une partie intégrante de la boîte, on cumule les stagiaires. On profite des volontaires – il y en a toujours : trop de demandeurs, pas assez d’emplois, après tout. Alors le travailleur devient un produit de consommation comme un autre, et il doit faire sa propre promotion : dans de nombreux domaines, les salariés ne le sont plus de manière stable, ils deviennent des sortes de micro-entrepreneurs, toujours en quête de missions, cumulant les CDD parce que les CDI ça coûte trop cher, cherchant à en faire toujours plus, à se donner à fond pour pouvoir s’accomplir en tant que personne intégrée socialement.
Car en voilà un, d’accomplissement ultime : avoir un travail stable, vivre sans précarité.
On me dit dans l’oreille que ça commence à sentir le vinaigre… Vous avez raison. J’arrive, attendez. On n’en est même pas encore à mille mots, après tout. Je crois que cet article va être long.
Je ne sais pas trop ce qui nous pousse ainsi, mais je crois qu’on est un peu tous à être en quête de quelque chose. Personnellement, j’ai jamais trop compris pourquoi j’étais sur cette Terre, et pour être honnête, je n’ai de fait pas toujours bien vécu d’être en vie. Alors j’ai fait comme tout le monde, j’ai suivi les sentiers qu’on me proposait.
Pourquoi vivre ? Pour être heureux.
C’est quoi être heureux ? C’est être accompli : dans son travail, dans une famille qu’on fonde… c’est avoir une place à soi où on se sent bien.
Ca y est, maintenant vous froncez franchement les sourcils. Je vous comprends. Moi aussi. Pourtant, j’ai beau me dire que tout ça, tous ces bonheurs préconçus auxquels on nous fait croire dès notre plus jeune âge, c’est un peu des conneries, au fond, c’est ancré à moi, et je ne m’en dépêtrerai pas si facilement.
Vivre, donc, c’est s’accomplir. OK. Alors allons-y mes p’tits, moi je vais m’accomplir, je vais me donner à fond, jusqu’au bout, je vais aller au maximum de mes capacités pour être heureuse dans ce que je fais.
Je vais être heureuse à me rendre malade !
J’ai essayé plein de trucs. D’abord, le relationnel. Je suis allée dans des extrêmes relationnels que j’aborderai dans d’autres articles, sinon je ne suis vraiment pas couchée. C’a failli avoir ma peau, c’était chouette. (Notez que je suis cynique, mais c’est un réflexe défensif. Si jamais je lâche là-dessus, je craque avant même d’avoir vraiment abordé le sujet que je voulais aborder).
Voyant que ça ne fonctionnait pas – il paraît qu’on ne peut pas vivre pour les autres – je me suis rabattue sur l’idée de vivre pour moi. D’être une personne accomplie dans mon travail ; m’insérer dans la société, glorieusement, en faisant un truc que j’aimerais, à fond.
Ca tombe bien, la société aime bien qu’on fasse les trucs à fond. Tous ces idéaux qu’on nous balance à la gueule, au fond, ils mettent bien en avant qu’on vit par ce qu’on fait et pas par ce qu’on est. Je veux dire, on ne vaut rien, si on ne fait qu’être, n’est-ce pas ?
Alors il faut faire, faire à fond.
Allez, lancez les citations.
Pour gagner et réussir, il faut mettre de côté une partie de soi-même. L’organisation opérant une confusion entre le faire et l’être et ne reconnaissant l’individu que pour ce qu’il fait, celui-ci se trouve pris dans la nécessité de répondre aux exigences de son entreprise : survalorisation de l’action, challenge permanent, obligation d’être fort, adaptabilité et disponibilité permanente… C’est cette nécessité d’adaptation de soi-même à la logique managériale qui peut finir, dans certains cas, par consumer l’individu.
— N. Aubert et V. De Gaulejac, Le Coût de l’excellence
Voilà, ça y est, on entre dans le vif du sujet. Toute à mes interrogations, au beau milieu de mon stage, voilà que je décide de faire la partie théorique de mon rapport d’étonnement. J’ignore si je dois remercier ou maudire mon enseignant de m’avoir conseillé ce livre, qui, par ailleurs, a paru en 1991. Il y a 24 ans, donc. On pourrait se dire qu’en un quart de siècle, les choses auraient évolué – mais j’y viens.
Mon stage est chouette. L’équipe est très sympa, l’organisation semble idyllique à mes yeux de non-initiée qui vient de débarquer. Je ne vais pas trop déballer, parce que vous savez, Internet est une place publique. Allons donc pour le minimum : une start-up bien dynamique, créative, le genre qui fait envie pour la place qu’elle laisse à l’innovation (mais si) et la liberté qu’elle donne aux employés. Une petite adhocratie à tendance configuration missionnaire, à en croire Mintzberg et ses structures organisationnelles : beaucoup de liberté, beaucoup de créativité, une idéologie bien présente (quelle qu’elle soit), vouée à devenir de plus en plus bureaucratique à mesure qu’elle s’éloignera de son statut de start-up. C’est une fatalité, ça, la bureaucratie, on dirait. Mais bon, en attendant, quand on ne se penche pas trop sur le truc, ça fait vachement envie.
(Et même, par rapport à mille et mille autres entreprises, ça fait envie. Je ne crache pas dans la soupe et tiens à rappeler que je ne tape pas sur cette boîte en particulier, mais bien sur l’idéologie générale qui semble régner sur l’intégralité du monde du travail.)
Et puis ensuite il y a la douche froide. Le rappel que, hé, c’est bien beau une entreprise fondée sur des bonnes idées, mais il y a une réalité économique dernière. On ne peut pas embaucher n’importe qui. Il faut que chacun fasse le boulot de quatre personnes. Il faut se donner à fond et plus qu’à fond.
Ah ? On en revient à se donner à fond. Car oui, même dans une petite structure à l’apparence utopique, on y revient. Il n’y a pas d’utopie, le retour de bâton de la réalité est bien présent. On n’échappe pas aux discours guerriers. Mais si, vous savez, ceux qui disent qu’il faut conquérir le marché. Ceux dans lesquels on établit un « war plan ». C’est toujours la guerre, toujours, et jamais il n’y a de consensus, jamais de possibilité de paix : quand on a vaincu une étape, on part à l’assaut d’une autre. Ca ne s’arrête jamais, et au milieu de tout ça, les employés sont les guerriers qui donnent tout ce qu’ils ont. Ils s’adaptent à cette exigence, pour faire toujours mieux, pour que l’entreprise avance.
Devereux parle de « modèles d’inconduite socialement admis dans les sociétés où prévaut une idéologie construite sur la réussite à travers le travail ». On y est : l’achèvement personnel passant par le travail, on ne compte plus ses efforts. Il y a un idéal à atteindre, vous comprenez.
Et puis soudain, ça y est. Les feux de la guerre nous atteignent.
On brûle.
C’est comme ça que Freudenberger en a parlé la première fois : la brûlure interne. En anglais, le burn-out.
Ce qui était auparavant un complexe plein de vie n’est plus maintenant qu’une structure déserte. Là où il y avait un édifice bourdonnant d’activités, il ne reste plus que quelques décombres pour nous rappeler toute la vie et l’énergie qui y régnaient. Peut-être quelque pan de mur reste-t-il encore debout, peut-être même distingue-t-on encore quelques fenêtres ; peut-être même que toute la structure extérieure est encore intacte, mais si vous vous hasardez à l’intérieur, vous serez frappé par l’ampleur de la désolation qui y existe… Les gens sont parfois victimes d’incendie, tout comme les immeubles. Sous l’effet de la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer comme sous l’action des flammes, ne laissant qu’un vide immense à l’intérieur, même si l’enveloppe externe semble plus ou moins intacte.
— H. Freudenberger, L’Epuisement professionnel, la brûlure interne
Vous le voyiez venir, n’est-ce pas ? Je vous entends déjà.
« Ah bah oui, ça, le burn-out, c’est la maladie de l’époque ! »
Pour sûr, on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Bon, je vous rappelle que Freudenberger, c’était il y a 30 ans, quand même. En 30 ans, on aurait pu faire des progrès, vous ne croyez pas ?
Hé bien non, au contraire. C’est de pire en pire.
Mais le vrai pire du pire, vous savez ce que c’est ? C’est que cette idée de feu qui dévore tout et laisse vide, c’est pas nouveau. La notion de burn-out a pris le pas sur une autre notion, qui, bien qu’elle fut nommée en 1869 par Beard, a été observée et étudiée depuis l’Antiquité, rien que ça : la neurasthénie. L’épuisement nerveux, quoi. Si je vous parle de Marcel Proust ou de Virginia Woolf, je suis sure que ça vous évoquera deux-trois trucs.
Mais bon, la mode de la neurasthénie est passée. Place au burn-out.
« J’en ai marre que tu fasses rien à la maison, que tu sois tout le temps épuisée, franchement je vois pas de quoi tu te plains, t’as un boulot pépère, t’en fais pas tant que ça, t’es gonflée. »
(Quoique la citation ne soit pas 100% juste, car je l’ai effacée au mieux de ma mémoire, Narcisse n’a pas été doux avec moi sur beaucoup de points. Mais il exprime le point de vue de beaucoup de gens : faire un burn-out c’est être faible, surjouer la fatigue, c’est un échec inadmissible.)[2]
J’étais prof d’anglais. Les profs, c’est bien connu, ils n’en foutent pas une. Alors je n’avais pas de raison d’être épuisée.
A une époque, j’ai été prof dans trois organismes différents, qui me faisaient passer une vingtaine d’heures dans les transports.
Je devenais cinglée, je pleurais tout le temps, j’annulais des cours de plus en plus souvent. Et pourtant, chaque fois qu’on me proposait des nouvelles missions, des nouveaux clients, je disais oui. Parce qu’il fallait que je fasse ces heures, ce travail, c’était le mien. C’était comme ça que j’allais m’en sortir. Il fallait travailler pour exister.
C’était ce que la société m’avait appris, après tout, non ? J’en voulais, moi. Je voulais réussir.
Ce mal semble lié à la société dans laquelle nous vivons. Il paraît découler de la lutte constante que nous menons pour donner un sens à notre vie : les idéaux d’excellence qui caractérisent notre société semblent ici directement en cause. […] L’individu se trouve en quelque sorte enfermé dans une spirale infernale, obligé de courir toujours plus vite dans une vie où tout change si rapidement qu’il ne reste plus rien de stable sur quoi s’accrocher pour reprendre son souffle : un peu comme Alice au pays des merveilles, nous nous apercevons maintenant « qu’il faut courir de toutes tes forces pour pouvoir rester au même endroit. Si tu veux aller ailleurs, il te faudra courir au moins deux fois plus vite ».
— N. Aubert et V. De Gaulejac, Le Coût de l’excellence [3]
Alors moi j’ai couru, couru, couru… Un premier tour à l’hôpital n’a pas suffi, je suis repartie de plus belle, en courant. Les premiers signes n’ont pas suffi. Ca traîne, ce genre de choses…
Le sentiment de brûlure interne ne se produit en général pas d’un seul coup, il s’installe peu à peu, le feu couve longtemps avant de flamber d’un seul coup, et des personnes qui avaient été pendant la plus grande partie de leur vie pleines d’enthousiasme, d’énergie et d’optimisme se mettent progressivement à éprouver une grande lassitude et une absence de vitalité. « Leur énergie se transforme en ennui, leur enthousiasme en colère et leur optimisme en désespoir. »
— N. Aubert et V. De Gaulejac, Le Coût de l’excellence
Et ensuite, on finit par ne plus voir de but en quoi que ce soit. Et on finit à l’hôpital une deuxième fois. Et cette fois-ci, personne ne s’y attendait parce que, hé, c’est vrai qu’on était fatigué ces derniers temps, mais après tout on était tellement plein de vie !
Bon, enfin, si tout ça semble lié à la société en général, alors pourquoi ne sommes nous pas tous en burn-out ? Aubert et Gaulejac apportent la réponse, en citant à nouveau Freudenberger.
La particularité de cette maladie est qu’elle atteint en général des gens nourrissant un idéal élevé et ayant mis le maximum d’efforts en oeuvre pour atteindre cet idéal. La plupart de ceux qui deviennent la proie de cette maladie sont des gens qui ont travaillé énergiquement pour atteindre un but : « Leur horaire est toujours plein et, quel que soit le travail à faire, on peut être certain qu’ils feront toujours plus que leur part. Ce sont généralement des leaders qui n’admettent pas qu’ils ont des limites et ils se brûlent à force d’exiger trop d’eux-mêmes. Tous ces gens avaient de grands espoirs et n’ont jamais voulu faire de compromis en cours de route. » En fait, si cette maladie atteint cette catégorie de personnes, c’est parce qu’elle est, spécifiquement, la maladie de l’idéalité. Selon Freudenberger, il est pratiquement impossible qu’une personne sans grand idéal ou qu’un individu vivant au jour le jour parvienne jamais à cet état. Les risques d’incendie semblent exclusivement limités aux hommes et aux femmes dynamiques « qui ont des aptitudes de leaders et de nombreux objectifs à atteindre », quelle que soit d’ailleurs la nature de ces objectifs, que l’individu les ait placés dans son mariage, dont il exige qu’il soit des plus réussis, dans son travail, qui doit être parfaitement accompli, ou dans ses enfants, pour lequels il espère une réussite brillante. Bref, il s’agit de gens qui s’engagent à fond dans tout ce qu’ils entreprennent, qui en éprouvent d’ailleurs pendant longtemps une profonde satisfaction et qui ont témoigné jusque là d’une énergie à revendre. »
— N. Aubert et V. De Gaulejac, Le Coût de l’excellence
Voilà. Des gens dévoués, qui en veulent, qui se battent, et qui finissent par tout lâcher. Je vais arrêter les citations, vous aurez compris que ce chapitre 5 du Coût de l’excellence m’a drôlement remuée.
Pour résumer la suite, Aubert et Gaulejac continuent dans leur analyse en plongeant dans la psychanalyse. C’est compliqué et un chouia technique, mais en gros, le burn-out arrive au moment où le travail n’est plus une récompense en soi : quand la déception s’installe petit à petit.
Ils mettent tout cela en parallèle avec une problématique narcissique ; la construction d’un Soi idéal, suite à une pression qui « pousse à devenir quelqu’un d’autre ». Elle peut être due, par exemple, à des parents qui transfèrent leur idéal sur leur enfant, le poussant à se surpasser, mais aussi être « interne et déclenchée par l’admiration portée à telle ou telle personne idéale ». Ou simplement par une société qui nous montre des idéaux maison-famille-jardin en campagne-appartement en ville à longueur de temps, dans tous les médias, au point que cela devient une sorte de norme à suivre.
On a désormais un cocktail explosif : une société qui nous impose un modèle d’excellence, et… oh, je ne résiste pas à vous mettre une dernière petite citation. Promis, après, j’arrête : de toute façon, je n’arrive pas au bout de ce chapitre 5 sans pleurer, et je pense m’être assez auto-flagellée pour aujourd’hui.
La peur et la honte qui s’attachent à l’échec dans la société narcissique qui nous entoure sont des sentiments omniprésents qui empêchent l’individu d’échapper à la pression du succès. […] Dans un tel contexte, l’individu est, plus qu’avant, conduit à développer et à poursuivre une image de lui-même en conformité avec des standards extérieurs d’excellence et de réussite, au détriment de sa personnalité réelle.
— N. Aubert et V. De Gaulejac, Le Coût de l’excellence [4]
Voilà. Le Soi idéal, imposé par l’entourage et surtout la société, et qui, peu à peu, remplace le Soi réel. Au bout d’un moment, le Soi réel est parti, disparu, « aux oubliettes ». Pourtant le Soi idéal n’est pas réel, et la personne, à mesure qu’elle avance dans son parcours (professionnel mais pas que, d’ailleurs : il y a des burn-outs relationnels, comme je le sous-entendais plus tôt) s’en rend compte et fait face à des déceptions. Ce autour de quoi elle s’est construite n’existe pas réellement. Les pièces s’éparpillent petit à petit, jusqu’à éclatement de l’idéal ; mais ce qu’il y avait avant est perdu.
Voilà donc les dangers de l’excellence. Depuis ces combats qu’on veut nous pousser à mener au sein d’une entreprise, pour qu’on donne le maximum, toujours, au point d’oublier tout le reste, d’oublier que nous ne sommes que des êtres humains, jusqu’à l’image même de la vie que nous donne la société dans laquelle nous évoluons.
Et c’est ainsi que je me retrouve. Je m’appelle Lia, j’ai un quart de siècle, la société m’a formée, modelée, détruite, et maintenant je ne sais plus qui je suis.
On est beaucoup, comme ça. Il n’y a pas d’âge. Il n’y a pas de genre. Il n’y a pas vraiment de statut social. Tout le monde peut être touché, désormais ; car on nous encourage, on nous pousse à suivre ces fameux idéaux, cette idée d’excellence socialement construite. [5]
L’avantage, c’est que malgré les baffes psychologiques que je me suis mangées ces dernières vingt-quatre heures, je suis désormais capable d’y voir un peu plus clair. Il y a quelque chose, quelque part, en moi, qui me pousse à m’accrocher encore à ce Moi idéal qui déconne complètement, que je passe mon temps à détruire violemment et reconstruire malgré tout, sans jamais parvenir à trouver où est la vraie Lia ; mais désormais, je sais un peu mieux ce que je cherche. Et surtout, je comprends. Je vois le chemin que j’ai parcouru. Je vois mieux mes erreurs, et je sais ce que je combats. Et je peux diriger ma colère, mon sentiment d’injustice, vers une entité. Je ne suis plus en colère contre la société parce qu’elle ne me donne pas ce que je mérite ; je suis en colère contre la société parce qu’elle m’a poussée vers un idéal irréalisable en termes humains, et qu’elle continue à le faire.
Franchement, je ne plaisante pas quand je dis que je n’ai aucune idée de ce que je suis. Je ne sais pas ce que j’aime. Je ne suis même pas sûre de réellement vouloir aider les gens, peut-être que ça aussi, c’est un idéal que je m’impose. Je n’arrive pas à distinguer les moments où je me sens réellement bien des moments où je veux juste aller bien, parce que « ce sont des moments où on va bien normalement ».
Et je ne suis pas la seule dans mon cas.
Alors maintenant, la vraie question, c’est…
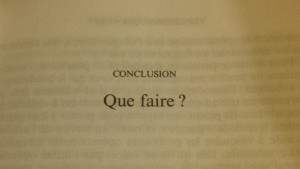
Car c’est là réellement la conclusion du livre d’Aubert et Gaulejac. Voyons quelle réponse ils ont à y apporter…
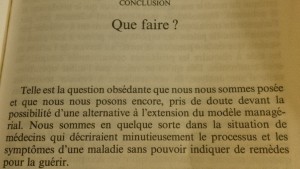
Le premier paragraphe est clair : nous savons ce qui ne va pas. Mais on n’a rien pour le résoudre.
Nous avons nous-mêmes creusé notre tombe – construit une société d’être humains qui n’aura bientôt plus rien d’humain – et maintenant, nous sommes coincés. [6]
Une piste de réflexion, pourtant, dans cette conclusion…
Il est urgent de reprendre un débat approfondi sur le capitalisme et sur la mission de l’entreprise, afin de sortir de la logique de guerre qui détermine actuellement tous les discours produits sur ce thème. Mais comment contrebalancer la logique du profit ?
— N. Aubert et V. De Gaulejac, Le Coût de l’excellence
Tout est dit. Je vous laisse vous interroger ; moi, j’ai une psychothérapie à suivre, histoire d’essayer de retrouver qui je suis. Je recommencerai à m’investir réellement dans la société une fois que j’aurai compris comment m’investir dans moi-même avant tout. Après tout, c’est un peu ce qu’on nous apprend aussi : moi avant les autres.
Hé bien voilà, presque cinq mille mots, ma foi ! J’ai fait quelques digressions mais dans l’ensemble, je suis contente de cette reprise de blog. Espérons que les prochains articles seront moins espacés.
En attendant, n’hésitez pas à me faire part de vos réflexions ou de votre vécu. Vous pourrez même me dire que j’en fais trop ou que je suis trop pessimiste. Vous ne seriez pas les premiers. C’est vrai qu’au fond je décrie beaucoup sans apporter de réponse : je n’en ai pas moi-même. Je suis totalement ouverte au débat, après tout, je n’ai pas plus de réponses que les auteurs des livres ; et je crois que nous sommes, quelque part, tous concernés.
Merci d’avoir lu, et rendez-vous au prochain article.
Lia
Point bibliographique :
(J’aime pas faire les bibliographies, alors vous aurez le minimum, désolée. Les normes bibliographiques me collent des boutons… Le cauchemar des mémoires.)
- Beard G., « Neurasthenia or Nervous Exhaustion« .
- Devereux G., « Ethnopsychoanalytic Reflections on Neurotic Fatigue » in Basic Problems in Ethnopsychiatry.
- Freudenberger H., L’Epuisement professionnel, la brûlure interne.
[1] Sur ce point, une petite anecdote : j’avais accompagné un ami à Pôle Emploi Spectacles, à Lyon. Pendant qu’il avait son entretien avec son conseiller, j’ai pu apprécier le travail de la personne à l’accueil, un petit bout de femme énergique qui indiquait clairement aux gens ce qu’ils avaient à faire et les aidait au maximum, même si parfois, certains haussaient le ton, l’agacement prenant le dessus. Au bout d’un moment, je suis allée la voir, ai présenté mon cursus, et lui ai demandé comment on faisait son job. Elle a soutenu mon regard et m’a asséné des mots que je ne suis pas près d’oublier.
« Vous avez un master ? Vous êtes trop diplômée. Ils ne veulent pas des gens qui réfléchissent trop. Je vois votre profil, on est beaucoup comme vous ici. Si vous voulez vous faire insulter à longueur de temps, par les gens qui viennent, par vos supérieurs, si vous voulez passer votre journée à courir, si vous voulez faire des journées de 10h non-stop malgré ce qu’il y a écrit sur votre contrat, si vous voulez ne jamais pouvoir faire ce pour quoi vous avez signé, si vraiment vous tenez à ne jamais avoir un poste stable, alors vous êtes au bon endroit. Mais si vous voulez aider les gens, réellement, alors ne postulez pas à Pôle Emploi. Je vous le redis. Vous pourrez peut-être trouver d’autres organismes plus réglo, je n’en suis pas sûre. Mais pitié. Tout, mais pas Pôle Emploi. Ca vous détruirait. »
Je n’ai pas insisté. Je suis retournée m’asseoir, j’ai observé les gens. Tous, les mêmes interrogations, les mêmes préoccupations, les mêmes sujets de rancoeur. Je l’ai observée, elle, qui faisait son travail, et j’ai compris ce qu’elle m’a dit. Ils ne sont plus assez, dans cette usine à gaz, et on en enlève encore. Plus de chômeurs, moins de conseillers. Et le but n’est pas d’aider les chômeurs. Le but est de faire un bon chiffre. Quitte à les envoyer n’importe où.
Sinon, avant ça, j’ai voulu être conseillère d’orientation-psychologue. Devinez quoi ? Petit à petit, le métier disparaît : de plus en plus, on demande aux profs d’assurer ce rôle. Ca tombe bien, les profs, ils n’ont que ça à foutre, ils ne rament pas déjà assez. Et puis j’ai vu la formation dispensée par l’Education Nationale aux COP. Autant dire qu’avec un truc pareil, à moins d’être dévoué corps et âme et franchement masochiste, on n’aide personne. Encore que, remarquez, c’est peut-être mon profil au fond. Je commence à vraiment me poser des questions.
En vrai, je commence à me dire que si je veux aider les gens, j’ai meilleur temps d’aller directement dans la rue et de parler aux gens. Mais ça, ça me fera pas bouffer, vous comprenez. C’est toujours une histoire d’argent.
Quand même fascinant comme ces histoires de fric nous font perdre toute préoccupation humaine…
[2] Autre exemple pas plus tard que ce matin : dans le bus, cette femme au téléphone derrière moi, parlant d’une connaissance. « Ben non, ça va pas bien au boulot, elle aime plus ce qu’elle fait, elle est à moitié folle, elle est triste, à 47 ans c’est la honte quand même. » Voilà : la honte. Et ce n’est pas une opinion isolée : c’est celle de la majorité. Mais à quoi pensons-nous ?
[3] La citation vient en réalité du magistral De l’autre côté du miroir et ce qu’Alice y trouva de Lewis Carroll. Quand je l’ai étudié, en master d’anglais, je n’y ai à vrai dire pas particulièrement vu une critique sociale, en tout cas pas sur ce point. Maintenant, j’aurais bien envie d’en faire une énième relecture. Il faudra que je vous poste des bouts de mon mémoire, à l’occasion, tiens.
[4] Franchement, la suite du paragraphe est passionnante, tout ce chapitre est extraordinairement éclairant et d’actualité malgré ses 25 ans d’âge, mais je n’ai pas la force de tout vous mettre. D’une, ce serait sans doute indigeste pour vous, et de deux, ça me renvoie à plein de souvenirs douloureux. Pour moi. Pour Narcisse, à qui j’arrive encore à trouver des excuses (tout est explicable en psychanalyse, après tout ; mais bordel, ça n’excuse rien et ça n’excusera jamais rien). Et puis bon, on rentre dans la psychologie clinique, et je vais être honnête avec vous : la psychologie clinique, ça farfouille, ça trifouille, je n’y comprends pas grand chose et pourtant ça me rend affreusement agressive. Lire du Freud me donne envie de tuer des gens. Ce n’est pas un hasard ; c’est ce qu’on appelle un réflexe défensif (ah tiens ? J’en aurai parlé dans cet article finalement), l’agressivité comme système de protection (vous n’avez jamais remarqué à quel point les gens en tort pouvaient se montrer violents ?). Moi c’est un peu mon « ultime rempart », alors quand je suis en colère, je fais tout mon possible pour m’écouter.
[5] Imaginez un enfant à qui on donnerait un paquet de cartes, et, pointant le château de Chambord, on lui dirait « Tiens, fais un château comme ça avec ces cartes, tu verras, ». L’enfant, toute à son imagination, bataille pour mettre ses cartes les unes sur les autres, et quand enfin il a plusieurs étages, il commence – dans son émerveillement enfantin – à être fier de sa construction, la société balance un grand coup de pied dedans en disant « C’est nul ! Ce n’est pas aussi beau que l’original ! Tu devrais avoir honte ! » Voilà, les idéaux sociaux, c’est ça. Un truc totalement inaccessible, mais qu’on nous présente au départ comme facile d’accès. Ca ne s’applique pas qu’au travail, bien sûr. Je suis sûre que vous saurez trouver d’autres applications : il n’y a pas besoin d’aller bien loin.
[6] Tant Freudenberger qu’Aubert et Gaulejac établissent un parallèle avec le mythe d’Icare : nous sommes ceux qui avons construit nos ailes pour nous approcher au plus du soleil et maintenant nous nous y brûlons. Le terme de burn-out ne vient pas de nulle part.