Un jour, une amie m’a dit « Mais en fait, ton délire à toi c’est de te mettre à la rue toute seule. »
C’était il y a sept ans et sur le coup, la formulation m’avait amusée. A l’époque, les circonstances faisaient que je ne pouvais pas lui donner tort. A posteriori, je me dis que d’une manière ou d’une autre, cette personne avait réussi à lire mon avenir.
Je n’ai pas de souvenir de mon premier déménagement, à part que c’était une des premières fois où j’ai eu le droit de monter devant dans un véhicule (un ENOOORME CAMION !) et que j’en étais très contente. En revanche, je me rappelle très bien le traumatisme engendré par mon deuxième déménagement, alors que j’avais presque huit ans : c’était la fin du monde. Déjà à l’époque, j’avais beaucoup de mal avec le changement, la perte de repères et l’inconnu.
Pour adoucir le choc, j’avais eu le droit de choisir ma chambre dans la nouvelle maison, et puis la tapisserie, et puis de faire ce que je voulais. C’était très bien : ça m’a permis de réinvestir un espace « à moi », d’en faire mon cocon, un presqu’appartement rien qu’à moi. J’ai recouvert les murs et le plafond de posters, j’ai déplacé les meubles encore et encore, j’ai rajouté des affaires, j’ai entassé : c’était ma tanière, cette époque bénie de l’adolescence où rester enfermé dans sa chambre et la décorer de manière absurde est parfaitement normal.
La chambre faisait largement la taille d’un appartement. Il y avait un grand placard dans lequel j’allais m’abriter parfois, un coin jour, un coin nuit, des posters et des peluches partout, de quoi héberger au moins cinq personnes. Ça a duré 9 ans. Un luxe énorme dont je n’ai pas pris la mesure, soyons honnête.
Puis je suis devenue indépendante, et j’ai eu la chance d’avoir un petit studio rien qu’à moi. Mais pas n’importe quel studio.
Une erreur dans une erreur, l’idée m’a bien plu. J’ai vite investi le studio, avec néanmoins le malaise de l’état « plus dans mon monde, pas encore dans LE Monde ». Cet appartement était mon chez moi mais pas trop, il manquait de vie, de… quelque chose. C’était ma tanière, mais une tanière froide, et je retrouvais avec soulagement la chambre chez mes parents tous les week-ends. (Et j’avais bien du mal à la quitter, ils témoigneront).
Pour autant, plus le temps a passé, plus j’ai investi. Dès le moment où j’ai commencé à couvrir les murs de bric et de broc et à accueillir des gens, c’est devenu de plus en plus un « chez moi ». Un nouveau cocon.
A partir d’avril ou mai de ma première année de fac, j’ai commencé à m’y sentir mieux, au point d’avoir du mal à le quitter. Retards répétés pour cause de faux départs, abandon de l’idée de sortir en me trouvant devant la porte… Force était de constater que cette première année très solitaire dans un appartement vide et une ville où je ne connaissais presque personne ne m’avait pas encouragée à apprendre à sortir de mon cocon.
Mais accueillir des gens, pas de souci : ça, je savais faire. (Et ça me jouera des tours, mais j’apprendrai.)
Et puis un jour, je me suis auto-fichue dehors. Enfin, pour cette première fois, je n’y étais pas pour grand chose. Je me souviendrai toujours de ce soir-là, je crois. Je venais de voir mon cousin, je rentrais chez moi, tranquillement, TNT d’AC/DC dans les oreilles (détail marquant), pour retrouver une armée de gyrophares dans ma rue, barrée.
« Une résidence a explosé. »
Au septième étage de l’immeuble, accident ou tentative de suicide ? Quelqu’un a fait sauter des bonbonnes de gaz. L’immeuble a été ébranlé. Nous sommes tous relogés dans le gymnase en face. Exit le cocon : me voilà sinistrée. Un bien grand terme pour me dire que je ne pouvais pas retourner dans mon « chez moi ». J’atterris chez des amis, loin de mes affaires, et j’écris pour évacuer.
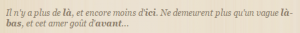 (Oui, j’avais déjà un bon sens du dramatique à 18 ans).
(Oui, j’avais déjà un bon sens du dramatique à 18 ans).
Finalement, j’ai eu de la chance de devoir attendre ma majorité pour connaître cette forme de traumatisme : celle de perdre mes repères, ma tanière.
C’était janvier de ma deuxième année de fac, je suis passée d’un endroit à un autre, une fois, deux fois, je promène mes quelques affaires jusqu’à être relogée pour cinq mois dans un « chez moi l’autre », que j’ai investi à son tour. Posters, affaires (dont certaines récupérées d’abord avec des pompiers, puis seule dans mon « vrai chez moi », où je n’avais plus le droit d’habiter tant que les vérifications de sécurité sur l’immeuble n’avaient pas été faites).
En parallèle, autre micro-drame (énorme à mon échelle) : chez mes parents, mon cocon a disparu, transvasé dans une autre chambre que mon subconscient refusera toujours de reconnaître comme « ma chambre ». Dans la logique, c’était plutôt normal : j’avais la plus grande chambre de la maison, et comme je la laissais vide 90% du temps, on l’a donnée à ma sœur. Dans la pratique, quand je rêve de « ma chambre », c’est toujours de la première. Il me faudra du temps pour investir la nouvelle chambre et je ne le ferai jamais totalement.
A ce stade, on pourrait se dire que je me suis blasée. C’était un peu le cas, sur certains points : la citation avec laquelle j’ai ouvert l’article n’est pas arrivé beaucoup plus tard, lorsque j’ai découvert que quelqu’un avait essayé de forcer la serrure du « chez moi l’autre » et que je ne pouvais plus rentrer chez moi. Par chance, il s’agissait d’une résidence-hôtel, et la réception m’a ouvert un nouvel appartement en attendant le serrurier. Je n’ai même pas paniqué, à ce stade. C’en devenait presque drôle.
Lorsque je suis arrivée en cours le lendemain sans affaires et avec les mêmes vêtements que la veille, ma réputation a été faite au sein de ma promo (qui avait déjà eu l’histoire de l’explosion même pas un mois plus tôt) : j’étais la fille dont la passion était de se foutre à la rue toute seule.
J’en ai ri, et pourtant intérieurement c’était la panique. Je passais d’un endroit à un autre, les choses changeaient et je ne savais pas les gérer. Je me suis prise à rêver de vivre dans une bulle solide qui flotterait au-dessus de la ville, un lieu inaccessible, indestructible, un endroit où j’aurais pu avoir ce dont j’avais besoin sans être trimbalée de ci de là sans arrêt.
Finalement, les choses se sont stabilisées. J’ai retrouvé mon appartement 404 en juin de la même année, et j’y ai transvasé la quantité indécente de bazar accumulée dans mon « chez moi l’autre ». J’ai changé la disposition des meubles pour me réapproprier le lieu et c’était reparti pour un an dans le même lieu, cette fois-ci sans incident…
…A ceci près que j’arrivais encore moins à sortir de mon cocon qu’avant, au point qu’il se passait parfois des semaines sans que je sorte, jusqu’au moment où une de mes amies finissait par venir me chercher et me traîner par les cheveux dehors pour « manger du gâteau au chocolat » (la meilleure excuse pour me forcer à sortir à cette époque). Du coup, parfois, je restais chez cette amie… pendant une semaine, parce que je n’arrivais plus à sortir de chez elle.
Je ne sais pas à quoi c’est dû, mais voilà : je n’arrive plus à sortir d’un cocon.
Je me roule en boule et j’ai perdu mes repères. Je me mets des coups de pied au derrière, des fois ça marche, d’autres fois non.
Le temps a passé. J’ai fini par rendre mon appartement, emménager pour deux mois chez mon copain de l’époque. L’expérience n’a pas été concluante : je suis territoriale et ne me sentais pas chez moi. Impossible d’investir le lieu ! Finalement, retourner chez mes parents a été un soulagement…
…pour mieux repartir. Lia Passion se foutre à la rue toute seule ? Autant voir les choses en grand. Ma maison doit tenir dans une valise de 20 kilos, car cette fois-ci, mon chez moi se fera en Chine. Arrivée difficile, terre hostile, je déprime pendant un mois dans la chambre vide du bâtiment des étudiants étrangers du campus, je peine à sortir, et je compense en remplissant le lieu de n’importe quoi que je peux trouver.
Finalement, quand on la regarde, c’était un vrai palace. J’avais juste du mal à en sortir. Et ensuite, mon petit ami de l’époque m’a rejointe, et je n’ai plus trop eu de chez moi, et ça s’est mal passé. Le retour en France a été un soulagement. Et ce sont presque 90 kilos d’affaires qui repartiront avec nous, parce que j’ai encore trop accumulé…
Retour en France, nous emménageons ensemble et je découvre malgré moi qu’en fait, non, la vie de couple dans un appartement à deux sans coin cocon pour moi, ce n’est pas ce qu’il me faut. Je personnalise sans investir. Quand nous rompons et que je quitte l’appartement, moins d’un an après, c’est un soulagement. Je commence par sous-louer un petit appartement pendant un mois, en l’investissant juste ce qu’il faut pour que je me sente bien, et puis place à un nouveau chez moi, et un de taille : l’Auberge.
L’Auberge, dès ses débuts, c’est une institution, un art de vivre. C’est un endroit où je veux que le monde entier puisse se sentir bien, tout en gardant ce lieu comme celui qui me ressemble le plus. C’est un salon grand avec un petit coin caché/tannière pour le lit, et une super cuisine pour inviter des gens à manger. Ce sont des coussins partout, des meubles ramassés dans la rue, de quoi loger dix personnes, des soirées à 20, un vidéoprojecteur avec plein de consoles pour jouer à plusieurs, des tonnes de livres pour me sentir bien, beaucoup trop d’instruments de musique… Même si comme d’habitude, je peine à en sortir plus d’une fois, et je reste parfois terrée jusqu’à ce qu’on vienne me chercher, vous pourrez demander à quiconque a connu cette période : l’Auberge, c’est l’âge d’or de mon indépendance.
Pas de chance, c’est aussi l’époque où je rencontre Narcisse.
Qui vient me voir à chaque vacances, pour qui je dois être disponible, qui fronce le nez chaque fois qu’un inconnu entre dans l’Auberge et me le fait regretter. Que j’invite à emménager après un an de relation à distance déjà mal fichue, parce que « c’est normal », parce que « j’ai envie ».
Bientôt mon Auberge devient un « nôtre » qui ne peut pas fonctionner. Mon cocon éclate, je dois le partager. Narcisse ne cesse de m’accuser de ne pas le faire se sentir chez lui, et j’ai du mal à lui donner tort, je suis toujours aussi territoriale. Je finis par ne plus vouloir rentrer « chez moi », je n’ai plus de refuge.
Finalement, coup sur coup sur coup, nous finissons par convenir que ce chez-moi de rêve est trop petit pour nous deux. J’accepte de déménager.
En signant le bail du nouvel appartement, j’ai la sensation de faire la pire bêtise de ma vie. En vidant l’appartement, je pleure toutes les larmes de mon cœur. En rendant les clefs, je découvre qu’il me restait des larmes.
J’ai abandonné mon Auberge. Faites que ça vaille le coup.
…
Bien sûr, ça ne valait pas le coup. Je n’ai jamais réussi à aimer ce nouvel appartement, qui a pourtant mes affaires, dans lequel j’ai pourtant créé « mon coin » (mais que Narcisse ne respecte pas, la plupart du temps). Il ne se passe que quatre mois avant que la situation explose.
Et c’est là que les choses deviennent intéressantes.
(Oui, je viens de vous faire une introduction du sujet de presque deux mille mots. Vous êtes toujours là ?)
En septembre 2014, pour plein de raisons que je vous ai déjà bien trop expliquées, je me retrouve « à la rue ». Avec l’impossibilité de retourner dans le lieu que les autres considèrent comme « chez moi » (même si je n’ai intérieurement plus de chez moi depuis un moment).
Je récupère des affaires, et je vais habiter chez des amis un moment. Une fois de plus, je n’ai plus aucun repère, et je prends la mesure de l’importance du « chez moi » pour moi. Je ne sais plus où me réfugier, tout est en chantier, tout bouge tout le temps. Je suis paniquée. Je ne sais pas où j’habite, littéralement. Le plus gros de mes affaires est renvoyé chez mes parents, et moi j’atterris en foyer psy. Un endroit chouette avec plein de gens intéressants et des règles strictes qui me donnent l’impression d’étouffer.
J’essaie de faire comme si c’était chez moi. Alors j’investis de la seule manière que je connais : je personnalise et j’accumule. Encore.
L’avantage, c’est que vu les conditions de vie du foyer, je n’ai pas de mal à en sortir, pour une fois. J’ai plutôt du mal à y retourner.
Deux mois plus tard, quand je quitte l’endroit pour… retourner habiter chez des amis un moment, j’ai à nouveau beaucoup trop d’affaires. Des livres, du matériel à dessin, des affiches, bien trop de choses.
Qui finissent par atterrir dans une colocation temporaire dans laquelle j’entrepose pour mieux aller squatter chez d’autres amis. (En vrai cette coloc était super cool, mais très mal située, et je commençais à prendre la bougeotte). De toute façon, à ce stade, il y a de quoi meubler un 60 mètres carrés dans le garage chez mes parents, la chambre chez mes parents est pleine d’affaires du foyer et de chez mes amis, j’ai aussi des affaires à la coloc, tout est éparpillé, je ne retrouve plus rien, et je suis à peu près aussi éparpillée que tout le reste.
Je n’ai plus de chez moi. Et ça me manque. C’est dur.
« Essayez la méditation », me dit ma psy de l’époque, franchement pas géniale (voire carrément toxique) sur plusieurs aspects, mais qui aura quand même le mérite de m’avoir aidée un peu notamment sur ça. « Faites des associations d’idées ».
Fort bien. Puisque je n’ai plus de chez moi, je vais me le construire à l’intérieur. C’est fragile, mais petit à petit, quand je peine à dormir, quand je peine à me concentrer, je meuble mon « jardin interne » avec des associations d’idées, puis en laissant les idées se transformer en couleurs, en notions, en pensées informes mais qui me calment. J’y découvre plein de choses (notamment que mon animal totem serait une baleine. Je ne sais que faire de cette information), et surtout un certain apaisement quand rien ne va plus.
En parallèle, je me décide enfin à tenir un vrai blog. Ce n’est pas grand chose, mais c’est un chez moi, sur Internet, où poser mes bagages. Un endroit où me recroqueviller quand ça ne va pas, et où m’autoriser à écrire pour évacuer. Et vu les histoires de mes « chez moi », quoi de plus logique que de l’appeler Erreur 404 ?..
Mais cette question de maison à moi me taraude quand même beaucoup. Une fois de plus : je suis perdue, je ne sais littéralement plus où j’habite.
Quand je pars en Suède pour la première fois en août 2015, c’est pleine d’incertitudes sur ce que je retrouverai en rentrant. Je ne sais pas où j’irai, ni ce que je ferai. C’est une angoisse latente à laquelle je refuse de penser… Sauf un soir de grande fatigue, où je me retrouve à discuter avec celui que j’appelle maintenant « mon jumeau suédois ». Comment ou pourquoi je me suis retrouvée à lui parler de ça, je n’en sais rien, mais d’un coup il me dit : « Arrête de t’en faire pour cette histoire. La maison, c’est où tu t’assois. Je crois que c’est Pumba qui dit ça. »
Ah bon ? Je n’ai pas particulièrement aimé le Roi Lion et la dernière fois que je l’ai vu, c’était il y a… longtemps. Je ne m’en rappelle pas.
Après vérification, c’est normal : Pumba le dit… mais en anglais et en suédois, et pas en français.
Allez, pour le plaisir :
« Home is where your rump rests. »
La maison, c’est l’endroit où tu poses tes fesses.
C’est tellement simple. Il souligne au passage que je suis beaucoup trop matérialiste et que ça me fait souffrir, visiblement. Moi j’ai envie de le baffer, parce que ce n’est pas normal que quelqu’un qui me connaît depuis 5 heures puisse me cerner si facilement.
Mais n’empêche. L’idée fait son chemin. Le matérialisme, c’est encore compliqué, mais la maison, j’intègre l’idée facilement. Après tout, j’avais déjà tous les éléments, j’avais mon jardin interne : il ne me manquait que cette petite phrase, comme si c’était la clef dont j’avais besoin pour accepter qu’en fait, chez moi, c’était partout.
J’ai peut-être trop intégré cette idée. A partir de ce moment, tous les endroits où je pouvais « me poser » sont devenus des « chez moi ».
Assise chez des amis ? Maison.
Assise chez mes parents ? Maison.
Confortablement installée dans un café ? Maison.
Posée tranquillement dans un bus pendant six heures ? Maison.
J’ai appris à me constituer ma maison en fermant les yeux. Musique dans les oreilles, carnet à la main, tant que je peux aligner des mots sur le papier ou sur mon blog et des couleurs dans ma tête, tant que je peux me réfugier dans mon jardin interne, pas de problème.
Je n’ai plus l’angoisse de la maison. J’ai toujours l’angoisse de la quitter. Descendre de ce bus, sortir de chez ces amis, c’est un effort énorme. Il faut m’arracher au cocon, et ça, j’ai encore beaucoup de travail à faire. Mais passer d’un endroit à un autre n’est plus un problème. Depuis novembre 2015, j’ai déménagé cinq ou six fois. Tantôt chez des amis, tantôt en coloc, tantôt en logement de fonction… Je suis sereine quand je bouge, sac sur le dos : qu’importe si j’oublie des affaires, s’il m’en manque. Je suis chez moi partout. Je ne me soucie plus de la maison : elle est en moi. Et si jamais je doute, il suffit que je ferme les yeux, que je mette mes écouteurs, que je plonge en moi et que j’extirpe quelques mots. C’est bien plus simple que tous les déménagements du monde.
Pourtant, ça ne m’empêche pas de continuer à beaucoup trop accumuler, où que j’aille. Des livres, des jeux, du matériel à dessin, des souvenirs… (mais surtout des livres). Tout ce que je possède devient source d’angoisse et pourtant je ne peux pas m’empêcher d’en ajouter encore et encore.
Et ça, c’est le prochain point sur lequel je travaillerai… et il va falloir, parce que cette semaine, voilà ce qui m’est arrivé :
Voilà. Après deux ans à errer, j’ai un chez moi à mon nom.
Tout le monde m’a félicitée. On m’a pressée pour faire une crémaillère. Il n’y en aura sans doute pas. Je crois que je n’ai pas vraiment réussi à faire comprendre à quel point tout ça me terrifie. C’est vrai, quoi, avoir un appartement, c’est une certaine forme de réussite sociale, non ?
Et pourtant cet appartement est une source immense d’angoisse. C’est un lieu d’où je pourrais ne plus réussir à sortir. Un lieu dans lequel je vais encore entasser des choses impossibles à déménager.
Je sais que je vais l’investir, et ça me fait tellement peur. Je n’ai pas envie de recommencer à entasser, pas envie d’être attachée à un lieu.
Mais voilà : maintenant que je sais passer d’un endroit à un autre, sans attache autre que l’endroit où je pose mon sac à dos, il va falloir que j’apprenne à me faire confiance. Me rappeler que ce n’est qu’une maison comme toutes les autres, et mettre mes écouteurs dans mes oreilles, saisir un carnet, laisser les couleurs se transformer en mot sur le papier. Inspirer un grand coup, plonger dans mon jardin intérieur, et continuer à mettre à jour mon blog.
Et peut-être, de temps en temps, pouvoir enfin accueillir à nouveau des gens dans un endroit chaleureux et accueillant… à l’enseigne de l’Auberge de la Page Perdue.









