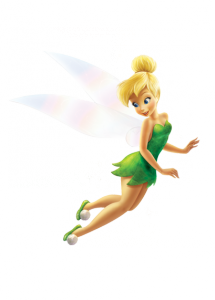Aujourd’hui, au Pays des Merveilles, j’ai fait peur à une visiteuse.
C’était rigolo.
Il faut savoir que quand je suis à la vérification des tasses, j’ai tout le loisir d’admirer les gens en train de se prendre en photo. Des fois, je prends l’appareil pour eux et j’immortalise leur moment en famille.
D’autres fois, l’occasion est trop belle de m’incruster sur un selfie, alors je ne résiste pas à une petite blague.
Cette fois-ci, ma cible était une mère et ses deux enfants. Ils avaient l’air sympathique (oui, on ne va quand même pas agir si librement avec des gens qui n’ont pas l’air commode : ce serait bête de créer des mécontentements pour des bêtises) et alors que la mère avait le bras tendu avec le téléphone au bout en tentant de cadrer tout le monde, je me suis glissée à leur droite. Au début, ça ne pose problème à personne : trop concentrés sur la tâche, ils ne s’aperçoivent de rien. Puis le fils se tourne vers moi. La mère voit qu’il se tourne, lui dit de regarder l’objectif… et sursaute.
« Mais y a quelqu’un en trop ! »
Je pars en rigolant, la photo est prise correctement cette fois et je lance mon tour.
A la sortie, je tiens la porte aux visiteurs. La famille est la dernière à sortir. Je les attendais au tournant (prête à m’excuser si jamais ça les avait trop perturbés, même si ça n’arrive jamais. Les gens sont bon public pour certaines choses).
La famille sort, et la mère se plante devant moi :
« Vous n’existez pas ! Vous n’existez pas ! Vous êtes un fantôme, qui ne parle pas, qui apparaît sur les photos, c’est ça ? Mais vous n’existez pas ! »
Elle riait, et dans le contexte j’ai ri aussi. Tout tournait autour de la blague, et on s’est souhaité une bonne journée, et ça m’a collé le sourire pour une bonne heure.
Mais en même temps ça m’a fait réfléchir à un aspect de mon travail qui est fondamental, et qui est également extrêmement présent dans ma vie. Le fait qu’on me voit, et que je vois les gens, et que donc, nous existons.
A posteriori, je me dis que « Vous n’existez pas », c’est quand même quelque chose de terrible à entendre. Je veux dire, concrètement, exister, c’est tout ce que j’ai de « certain ». Je suis là, quoi. Personne ne peut m’enlever ça. Si on me l’enlève, que reste-t-il ?
Ca me rappelle la panique qu’Alice éprouve dans De l’autre côté du miroir, lorsque Tweedledee lui fait croire qu’elle n’est pas réelle et ne fait que partie du rêve du Roi rouge…
‘He’s dreaming now,’ said Tweedledee: ‘and what do you think he’s dreaming about?’
Alice said ‘Nobody can guess that.’
‘Why, about you!’ Tweedledee exclaimed, clapping his hands triumphantly. ‘And if he left off dreaming about you, where do you suppose you’d be?’
‘Where I am now, of course,’ said Alice.
‘Not you!’ Tweedledee retorted contemptuously. ‘You’d be nowhere. Why, you’re only a sort of thing in his dream!’
‘If that there King was to wake,’ added Tweedledum, ‘you’d go out—bang!—just like a candle!’
‘I shouldn’t!’ Alice exclaimed indignantly. ‘Besides, if I’m only a sort of thing in his dream, what are you, I should like to know?’
‘Ditto’ said Tweedledum.
‘Ditto, ditto’ cried Tweedledee.
He shouted this so loud that Alice couldn’t help saying, ‘Hush! You’ll be waking him, I’m afraid, if you make so much noise.’
‘Well, it no use your talking about waking him,’ said Tweedledum, ‘when you’re only one of the things in his dream. You know very well you’re not real.’
‘I am real!’ said Alice and began to cry.
‘You won’t make yourself a bit realler by crying,’ Tweedledee remarked: ‘there’s nothing to cry about.’
‘If I wasn’t real,’ Alice said—half-laughing through her tears, it all seemed so ridiculous—’I shouldn’t be able to cry.’
‘I hope you don’t suppose those are real tears?’ Tweedledum interrupted in a tone of great contempt.
‘I know they’re talking nonsense,’ Alice thought to herself: ‘and it’s foolish to cry about it.’ So she brushed away her tears, and went on as cheerfully as she could. ‘At any rate I’d better be getting out of the wood, for really it’s coming on very dark. Do you think it’s going to rain?’
Pour lutter contre l’angoisse de cette potentielle non-existence, elle rationalise, et passe à autre chose. Parce que « ça n’a aucun sens », après tout. Alors le sens, on le cherche ailleurs.
Bon, j’avoue : mes recherches pour mon master ont laissé des traces. Vous avez forcément déjà eu vent de mon mémoire sur le nonsense et l’absurde. J’y ai consacré toute une partie sur l’existentialisme, qui constitue une part importante de l’interprétation qu’on peut faire de ces œuvres. (Oui, parce que le nonsense et l’absurde, ça n’est pas autant « n’importe quoi et c’est tout » qu’on pourrait le croire au prime abord. Faites-moi confiance en attendant que je vous poste mon mémoire.)
J’avoue également que dans ces recherches, j’ai pas mal trouvé mon compte. Le côté « la vie n’a pas de sens, il ne tient qu’à toi de lui en donner un », ça me plaisait bien. Ca n’était pas facile, et j’ai mis du temps à mettre les points sur mes propres i. La quête de sens a eu un impact non négligeable sur la fin de mes études, sur mes réorientations, sur la plupart de mes choix de vie ces derniers mois, à vrai dire.
Quand je vois où j’en suis maintenant, je me dis que je n’ai pas dû me tromper trop.
Mais revenons à nos moutons. « Vous n’existez pas », donc. On est beaucoup à chercher une preuve qu’on existe. J’ai pu observer que la plupart du temps, on a surtout recours au regard des autres pour « valider » notre existence.
Ce qui me renvoie à cette extraordinaire vidéo d’Amanda Palmer (par ailleurs une très bonne introduction à son livre The Art of Asking, que j’ai commencé à traduire en dilettante, parce qu’il faut absolument que les non-anglophones de mon entourage y aient accès. Mais je vous en parlerai plus ultérieurement, je pense), sur le sujet de l’importance de voir l’autre.
(je vous vois, les anglophobes. Vous n’avez pas d’excuse : activez les sous-titres.)
Le pouvoir du regard, je le constate au quotidien. Je crois que c’est ce qui me frappe le plus dans mon travail. Au Pays des Merveilles, on nous fait comprendre dès notre arrivée que si nous sommes là, c’est avant tout pour mettre à la disposition du public un produit dont il raffole : le bonheur.
Plus j’y réfléchis et plus je me dis que ça va plus loin que ça. Bien sûr, ils sont heureux. Il y a la magie, il y a les décors, les attractions, il y a toutes les paillettes propres au Pays des Merveilles. Mais aussi, et surtout : ils existent. Dans un monde où j’ai l’impression qu’on se perd de plus en plus (en même temps, il s’agirait quand même de ne pas avoir trop de personnalité, ce n’est pas très bien vu. Mieux vaut s’effacer dans la foule et se faire oublier en suivant les routes tracées… mais c’est peut-être mon cynisme qui parle), les visiteurs arrivent à un endroit où, à chaque entrée, à chaque sortie, quelqu’un leur dit bonjour, au revoir. Leur souhaite du bien, une bonne journée. S’inquiète de ce qu’ils passent un bon séjour.
Bien sûr, tous mes collègues ne le font pas. On se lasse, au bout d’un moment, les mots et gestes deviennent mécaniques et on finit par oublier que les gens en face de nous sont… chacun une personne, en fait.
Entre deux angoisses, j’en ai un peu parlé dans cette série de tweets : au travail, je mets un point d’honneur à essayer de dire bonjour à chaque visiteur. Et je fais plus que les voir passer : je les regarde. Et ça compte tellement. Et ça va dans les deux sens.
Beaucoup de visiteurs, trop pris dans le feu de l’action, la course pour rentabiliser le prix de leur séjour en faisant toutes les attractions qu’ils ont prévues, ou simplement si lassés de s’entendre dire « bonjour » toute la journée qu’ils ne cherchent même plus à relever, me voient à peine, m’ignorent totalement quand je leur dis bonjour, quand je leur souris, les regarde.
Ca fait toujours un peu mal. Comme les cyniques qui sont persuadés d’avoir tout compris au fonctionnement de l’entreprise, certains que je fais ça mécaniquement, hypocritement, « parce que je suis payée pour ça ». Je ne leur en veux pas, mais c’est triste.
Mais il y a ceux qui, à leur tour, font plus que me voir : ils me regardent. Ils regardent le nom sur ma poitrine, s’adressent à moi directement. Ils disent, à leur tour, bonjour et merci. Me souhaitent une bonne journée, un bon courage même parfois. Ont le mot pour rire, même s’il est des fois un peu lourdingue. Il y a ceux surpris en bien, ceux qu’on voit se redécouvrir, dans un endroit où les gens sont là « pour vous » et pas « contre vous ». Ils se laissent plus aller à vivre. Et il y a les enfants, qui découvrent un endroit où, enfin, on les voit : on est là d’abord pour eux, ensuite pour leurs parents. Au Pays des Merveilles, ce sont eux qui prennent les décisions. Et nous les écoutons : beaucoup n’ont pas l’habitude d’exister à ce point, à un âge où on est facilement écrasé par l’autorité parentale et le conformisme imposé à l’école. Alors ils sourient, et ils ont les yeux qui brillent. Et croyez-moi : je n’aime pas les enfants. Mais il n’y a rien qui me certifie plus que je suis à l’endroit où je dois être que le regard émerveillé d’un enfant ou son rire quand la tasse se met à tourner.
Certains jours, je suis en forme, prête à me donner à fond. Alors, ces jours-là, je souris plus que jamais, j’accueille tout le monde pour dix, je m’applatis à terre devant les petites princesses, je fais mine d’être terrorisée par les petits pirates, je salue les petits jedis, et je plaisante avec leurs parents. Je m’adapte à toutes les langues, tâche de dire bonjour à chacun dans sa langue à lui. Je réponds en souriant, parfois même avant que la question soit posée. Et je m’éclate à faire tout ça. Et je chante en travaillant, littéralement, parce que ce n’est pas très dur de chanter dans un environnement pareil.
Et puis il y a d’autres jours, comme certains cette semaine (qui a été un peu difficile, notamment avec un déménagement sur les chapeaux de roues et des nuits de 3h maximum), où je n’ai pas la force et je me demande même comment je fais pour tenir encore debout alors que je n’ai rien dans le ventre, qu’il fait moins cinq degrés, et qu’aucun visiteur ne daigne même lever les yeux vers moi quand je lui dis bonjour. Ces jours-là, j’ai un peu plus de mal à donner.
Mais s’il y a une chose que j’aime avec ma vie, c’est que quand je suis mal, « au fond », il y a toujours des petits miracles pour me surprendre. Et ces jours-là, il suffit de quelqu’un pour me souhaiter bon courage, quelqu’un qui pose le regard sur mon nom, un sourire sincère ou un enfant qui me lance un « c’était génial ! » à la fin de l’attraction pour que je reprenne un peu de poil de la bête, pour que je tienne une heure de plus, pour que je recommence à faire des blagues aux visiteurs. Comme aujourd’hui.
Ce qui est formidable, au Pays des Merveilles, c’est que même si nous sommes des milliers à faire vivre la magie pour des dizaines de milliers qui défilent devant nous chaque jour, ce genre d’occurrence arrive. Au moins une fois par jour. Trois ou quatre fois, plus souvent. Certains jours, une fois par heure, même. Alors l’échange est constant. Si la journée commence bien, j’offre un sourire à quelqu’un qui ne l’attend pas, et je lui rends sa journée plus belle. Si une contrariété survient (et tant mon entourage proche que ma liste de followers sur Twitter savent que je me fais facilement atteindre par les contrariétés…) et que je n’ai plus la force de sourire, je passe en mode « mécanique » en attendant que ça passe… jusqu’à ce qu’à son tour, un visiteur illumine ma journée.
Ne nous mentons pas : il y a des jours où je n’ai plus trop la foi en quittant le Pays des Merveilles. Mais ses visiteurs ne perdent jamais leur capacité à me surprendre, trop souvent en mal, mais parfois en bien, et c’est ce qui fait la richesse de mon travail.
Quand j’étais enseignante, je tentais aussi de cultiver l’échange, et je sais, par certains de mes anciens élèves, que cela a fonctionné à plusieurs reprises. (C’était d’ailleurs ce qui m’avait poussée à me lancer dans la psychologie).
Pourtant, la relation était trop inégale pour que cela fonctionne vraiment, en tout cas pour moi. J’aurais des anecdotes magnifiques à vous raconter ; celui-ci qui m’annonce qu’il a dévoré le livre que je lui avais conseillé, ceux-là qui m’offrent des chocolats pour me remercier, ce dernier qui vient à la fin du cours en me demandant s’il pouvait me parler, car il ne savait plus à qui s’adresser, et qui repartait en me remerciant, et que j’étais sûre d’avoir aidé.
Mais les occurrences étaient trop faibles, pour moi, et les échanges souvent trop à sens unique. Je crois qu’au fond, plus que de la communication suivie que j’avais avec mes classes, c’était de ces relations instantanées que j’avais besoin. De ces mini-coups de foudre, disparus en un battement de cils, de ces minuscules échanges de regards, d’existence. De pouvoir rappeler aux gens, au quotidien, qu’ils sont là et qu’ils en ont le droit, et qu’à leur tour ils me le rappellent. Il me semble de plus partager ainsi, en voyant pourtant les gens moins longtemps. Et que c’est beaucoup plus équitable et gratifiant.
Ca ne fonctionnerait pas pour tout le monde. Mais pour le moment (je ne doute pas que ça va évoluer et changer : ça évolue et change toujours), je crois que c’est ça qui fonctionne, pour moi. C’est ce qui donne « du sens » à tout ça, aux paillettes et au carton pâte qui pourraient tant me déranger : les gens qui rient et les enfants qui ont les yeux qui brillent. Le bonheur des autres, et le mien.
Il me semble en tout cas que c’est ce que j’ai pu comprendre sur moi, ces derniers temps. D’une prof « Serveuse automate » (« J’veux pas travailler juste pour travailler, gagner sa vie, comme on dit… »), j’ai réussi à travers des échanges de regards à mettre un peu de sens dans tout ça.
Moi qui voulais, initialement, vous faire un article cette semaine sur les visiteurs qui me font perdre la foi en l’humanité… cet épisode d’aujourd’hui a totalement changé mes plans et voilà qu’au contraire, je me retrouve à vous faire un pamphlet de foi en l’humanité. Je suppose qu’on en a tous besoin, à un moment ou un autre.
Tout ça, c’est valable pour le Pays des Merveilles, mais c’est aussi valable partout. Je pourrais vous faire un laïus sur la robotisation des gens dans les grandes villes, sur l’absence de sourires dans le métro, sur la peur de l’autre. Mais vous avez déjà tous lu des choses là-dessus. Et même si vous ne l’avez pas fait, vous avez forcément déjà observé ça par vous-même. C’est devenu un automatisme. Pour moi aussi. Parce qu’on ne sait pas sur qui on peut tomber, il faut toujours se méfier.
Et c’est triste. Parce qu’au fond, petit à petit, on ne regarde plus, on essaie même de ne plus voir. Et à la longue, on apprend à ne plus exister.
Alors je ne peux que vous inviter à essayer d’y réfléchir. Et, quand vous vous en sentez le cœur (il faut qu’il soit suffisamment accroché), faire plus que voir : essayer de regarder. Personnellement, ça m’a attiré des mésaventures, plein. Mais comme ça m’a aussi offert plein de bonnes surprises, je n’ai pas envie d’arrêter.
Et pour conclure cet article qui s’est avéré (une fois de plus) bien plus long que ce que j’avais anticipé, je vous renvoie aux réflexions existentialistes d’une philosophe bien connue.
Tant de libertés pour si peu de bonheur,
Est-ce que ça vaut la peine ?[…]
Résiste, prouve que tu existes !
(Un grand merci à Elly qui a mis en pause ses activités artistiques autrement plus glorieuses exprès pour me faire passer ce fichier audio sous la barre des 2mo.)
Avant de vous dire au revoir, parce que je sais que pas mal d’entre vous ne sont pas forcément en très bons termes avec la langue anglaise, voilà la traduction du passage de De l’autre côté du miroir, issue de cette version.
– Il est en train de rêver, déclara Blanc Bonnet, et de quoi crois-tu qu’il rêve ?
– Personne ne peut deviner cela, répondit Alice.
– Mais, voyons, il rêve de toi ! s’exclama Blanc Bonnet, en battant des mains d’un air de triomphe. Et s’il cessait de rêver de toi, où crois-tu que tu serais ?
– Où je suis à présent, bien sûr, dit Alice.
– Pas du tout ! répliqua Blanc Bonnet d’un ton méprisant. Tu n’es qu’un des éléments de son rêve !
– Si ce Roi qu’est là venait à se réveiller, ajouta Bonnet Blanc, tu disparaîtrais – pfutt ! – comme une bougie qui s’éteint !
– C’est faux ! protesta Alice d’un ton indigné. D’ailleurs, si, moi, je suis un des éléments de son rêve, je voudrais bien savoir ce que vous êtes, vous ?
– Idem, répondit Bonnet Blanc.
– Idem, idem ! cria Blanc Bonnet.
Il cria si fort qu’Alice ne put s’empêcher de dire :
– Chut ! Vous allez le réveiller si vous faites tant de bruit.
– Voyons, pourquoi parles-tu de le réveiller, demanda Blanc Bonnet, puisque tu n’es qu’un des éléments de son rêve ? Tu sais très bien que tu n’es pas réelle.
– Mais si, je suis réelle ! affirma Alice, en se mettant à pleurer.
– Tu ne te rendras pas plus réelle en pleurant, fit observer Blanc Bonnet. D’ailleurs, il n’y a pas de quoi pleurer.
– Si je n’étais pas réelle, dit Alice (en riant à travers ses larmes, tellement tout cela lui semblait ridicule), je serais incapable de pleurer.
– J’espère que tu ne crois pas que ce sont de vraies larmes ? demanda Blanc Bonnet avec le plus grand mépris.
« Je sais qu’ils disent des bêtises, pensa Alice, et je suis stupide de pleurer. »
Là-dessus, elle essuya ses larmes, et continua aussi gaiement que possible :
– En tout cas, je ferais mieux de sortir du bois, car, vraiment, il commence à faire très sombre. Croyez-vous qu’il va pleuvoir ?
Et c’est sur les mots plein de nonsense de ce bon vieux Charles que je vous souhaite de prendre soin de vous… en attendant la semaine prochaine !